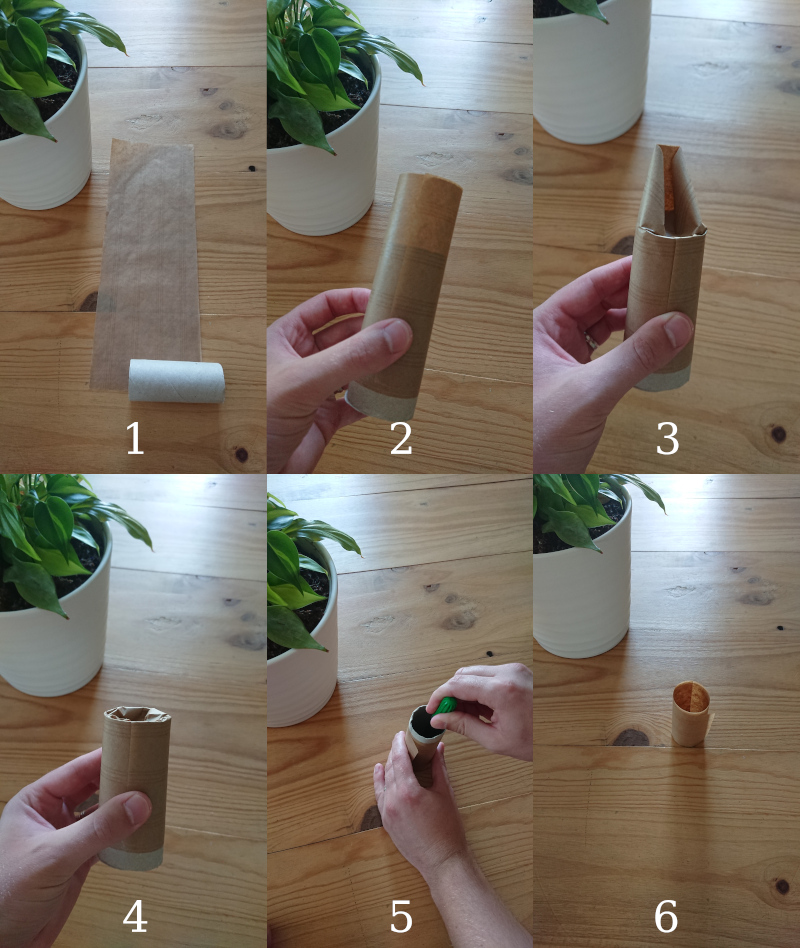1 an, le bilan !
Déjà un an que le projet est né dans ma tête, il est donc temps pour moi de faire un premier bilan.
Si c’était à refaire, qu’est-ce que je changerais ?
Les engrais verts
Pour commencer, avec un peu de recul, je pense qu’il était inutile de semer des engrais verts.
Même au-delà du fait qu’ils n’ont pas poussé, sans doute parce que la terre n’était pas nue (seulement tondue) et que les oiseaux ont certainement mangé une bonne partie des graines, je pense aujourd’hui que semer des engrais verts dans le cadre d’un projet de forêt comestible n’est pas utile.
En effet, ce qu’on appelle la banque de graines du sol, c’est à dire l’ensemble des graines dormantes présentes naturellement dans le sol, permet à ce sol de se régénérer naturellement. Autrement dit, pour améliorer le sol, il suffit de laisser l’herbe pousser sans intervention (peut-être couper simplement une fois par an pour éviter que les ronces envahissent tout et que le lieu devienne infranchissable). C’est ce que nous faisons désormais.
Le semis d’arbres
Le deuxième échec dont j’ai appris concerne le semis d’aulnes et de myriques. Un seul plant a émergé dans le pot censé contenir des myriques, et aucun dans la balconnière où devaient pousser des aulnes. Pour ces derniers à vrai dire, des pousses ont germées puis ont disparu mais je n’ai aucune certitude qu’il s’agissait bien d’aulnes, tout comme je n’ai pas la conviction que le plant qui se trouve aujourd’hui dans le pot où j’ai semé des myriques est bien un myrique…

Là est le premier problème : en laissant les plants dehors et avec si peu de germination, il est difficile de savoir si ce qui pousse est bien ce qu’on a semé ! Des graines ont très bien pu être transportées par le vent ou par un animal et finir par germer.
Le second problème, c’est qu’en laissant des pots en pleine nature et sans protection, il est très probable que les graines ou les jeunes plants soient dévorés… C’est sans doute ce qu’il s’est passé : des oiseaux ou des souris ou autres rongeurs ont peut-être mangé les graines ou bien encore des limaces ont avalé les jeunes plantules.
Dans tous les cas, le taux de réussite est assez proche de zéro pour ces premiers semis d’arbres ! Peut-être même est-il de zéro si la plante que je pense pouvoir être un myrique se révèle être tout autre chose.
Le paillage
Le paillage constitue un troisième sujet sur lequel je ne ferais plus les mêmes choix aujourd’hui. J’expliquais dans l’article dédié que j’avais commencé par pailler mes plants avec du carton et que j’avais changé d’avis et avais finalement opté pour de la bâche plastique en voyant que le carton se dégradait trop rapidement.
Il s’avère que certains plants ont montré des signes de faiblesse suite à la mise en place de la bâche, ce qui me laisse penser qu’elle n’est pas sans impact négatif.
Par ailleurs, la bâche est constituée de fils de plastiques tissés qui, lors de la découpe mais peut-être aussi par l’effet du temps, a laissé des morceaux de fils plastiques verts et noirs un peu partout dans le jardin… J’en ramasse régulièrement depuis pour les jeter. Cet aspect non écologique me dérange.
Ainsi, je pense à l’avenir utiliser plutôt du foin en guise de paillis autour des plants d’arbres et arbustes (foin qui je l’espère tiendra assez bien malgré le vent) et je réserverai la bâche plastique pour faire mourir les herbes en vue de planter des espèces couvre-sols, plus petites (menthes, fraises, etc).

Premières pertes
Enfin, dernier point que je souhaite évoquer : les plants qui se sont affaiblis voire qui sont morts.
Le nectarinier n’a de son côté jamais repris après l’hiver. J’ai découvert récemment des galeries souterraines aux abords du nectarinier, à attribuer peut-être à des campagnols terrestres. Mais les campagnols sont-ils venus manger les racines de l’arbre parce qu’il était mort ou ont-ils provoquer la mort de l’arbre ? Je n’ai pas la réponse aujourd’hui. S’ils ne sont pas responsables, j’ai trouvé une autre explication possible : après plusieurs recherches, j’ai découvert que les espèces les plus sensibles au froid doivent plutôt être plantées au printemps afin de ne pas subir un hiver avant d’être bien établies, le contraire de ce qui est conseillé pour les espèces plus rustiques pour lesquelles il est préférable de planter en automne pour qu’elles aient le temps de s’installer avant de subir l’été chaud et sec !
La sécheresse, parlons-en. Elle a causé la mort de plusieurs plants, notamment un genévrier et un argousier. D’autres plants ont également beaucoup soufferts mais ont encore une chance de reprendre de la vigueur : d’autres genévriers, un pommier, le poirier, le quetschier, le myrtillier, un goumi du japon et l’ensemble des noisetiers.
Cet été a été particulièrement sec. Beaucoup plus sec que l’année dernière, qui était elle-même déjà plus sèche que les années passées. Je pense qu’il va malheureusement falloir s’y habituer…
Cela dit, notre impatience à voir la forêt se densifier nous a poussé à planter de nombreux arbres avant d’avoir un système d’irrigation efficace. Pour arroser efficacement chaque plant, j’ai besoin de près d’une heure avec le simple tuyau que j’ai actuellement. Si je devais recommencer, je pense que je commencerais par installer des tuyaux poreux pour arroser l’ensemble des jeunes plants sans trop d’effort. J’ai d’ailleurs commandé 2 tuyaux : mieux vaut tard que jamais ! (Ils serviront dès cette année tant que la pluie ne se décide pas à tomber, et sans aucun doute les prochains étés.)
Une autre chose que je ferais différemment si je devais recommencer : je planterais de nombreux AFI dès la première année. Là aussi, c’est ce que je vais faire avec les 3000 plants prévus l’année prochaine mais je pense que ça aurait été bénéfique de le faire dès le départ.
Conclusion
J’ai appris beaucoup de choses de ces erreurs et de ces essais. D’autres lectures préalables auraient pu m’éviter certaines déconvenues et en même temps il faut bien commencer un jour : me documenter trop longtemps aurait peut-être plus retardé encore l’établissement de ma forêt ! Je ne regrette donc rien puisque c’est justement par l’expérience que j’ai pu avoir ces réflexions.
Avec une importante densification des plants (les fameux 3000), un meilleur système d’irrigation, le foin en guise de paillage, une meilleure protection des semis et la régénération naturelle, je pense que notre forêt va profondément se transformer l’année qui vient !